Le corps humain est segmenté en plusieurs régions anatomiques, interconnectées par des réseaux artériels, veineux, nerveux et articulaires. En traumatologie, certaines régions du corps sont de véritables pièges hémorragiques. Ces cinq régions spécifiques appelées «blood boxes» (littéralement « boîtes à sang » et francisées en « zones hémorragiques majeures ») concentrent le risque vital en quelques centimètres cubes. Ces régions sont le thorax, l’abdomen, le bassin, et les deux fémurs.
Ces zones ne constituent pas uniquement un découpage anatomique : elles représentent un véritable outil clinico-opérationnel pour le premier intervenant. Connaître les Blood Boxes, c’est savoir où chercher activement le sang, où porter son attention diagnostique et quelles zones contrôler en priorité en cas d’instabilité hémodynamique.
Cette approche, désormais intégrée dans la médecine tactique, préhospitalière et hospitalière, structure les gestes d’évaluation, de surveillance et de contrôle hémorragique dès les premières minutes de la prise en charge.
Les 5 Blood Boxes sont :
- Le Thorax : La région thoracique présente un risque élevé d’hémorragie en raison de la présence d’organes vitaux (cœur, poumons) et de gros vaisseaux (aorte ascendante, crosse aortique, aorte thoracique, veine cave supérieure et partiellement la veine cave inférieure). Une fracture costale déplacée peut entraîner une hémorragie d’environ 125 ml et présente un risque de lésion vasculaire ou organique.
- L’Abdomen : L’abdomen est également une région à fort risque hémorragique en raison des nombreux organes (estomac, intestins, foie, rate) et de gros vaisseaux (aorte abdominale, veine cave inférieure, artère hépatique, artère rénale) qu’il contient.
- Le Bassin : Le bassin, l’un des plus grands os plats du corps humain, est susceptible de provoquer des pertes sanguines massives en cas de fracture. Outre la fracture osseuse elle-même, des lésions vasculaires peuvent se produire, affectant notamment l’aorte abdominale distale, la veine cave inférieure et les bifurcations artérielles et veineuses iliaques. La perte sanguine associée peut varier de 500 ml à plus de 4 litres, avec un risque élevé de décès en cas d’hémorragie incontrôlée.
- Les Fémurs : Les fémurs, les os les plus longs du corps, peuvent entraîner une perte sanguine importante en cas de fracture, estimée entre 1 et 2 litres. Les complications secondaires incluent des lésions de l’artère fémorale, de la veine iliaque, ou d’autres structures vasculaires adjacentes, aggravant ainsi le tableau hémorragique.
Hémorragie associée aux fractures osseuses
Toute fracture osseuse génère une perte sanguine plus ou moins importante, selon la localisation et la gravité de la fracture. Par exemple, une fracture de l’humérus peut entraîner une perte de 500 à 750 ml de sang, et une fracture de l’un des os de l’avant-bras, entre 250 et 500 ml. Dans les membres inférieurs, une fracture tibiale peut causer une perte sanguine de 250 à 500 ml. Lors de traumatismes à haute énergie affectant plusieurs segments osseux, les pertes sanguines doivent être cumulées, augmentant significativement le risque de choc hémorragique.
Evaluation et surveillance hémorragique : le score A.B.C et l'écho FAST
L’identification rapide de ces zones critiques doit s’accompagner d’une surveillance étroite, fondée sur des scores cliniques validés et des outils d’imagerie.
Le score A.B.C
En cas d’estimation de perte sanguine importante (il existe plusieurs méthodes pour quantifier les pertes sanguines), l’utilisation du score A.B.C. (Assessment of Blood Consumption) peut être utile.
Il se définit par la recherche de 4 critères :
- Pression artérielle systolique ≤ 90 mmHg
- Fréquence cardiaque ≥ 120 battements par minute
- Présence d’une blessure pénétrante au tronc
- Présence d’un épanchement hémorragique décelable à l'échographie FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma).
La présence de 2 de ces 4 critères justifie la mise en route d’un protocole de transfusion (parfois massive).
Le shock Index (ou indice de choc), simplification de ce score, lui est souvent préféré. Calculé simplement comme le rapport FC/PAS, il permet une évaluation rapide de la gravité hémodynamique, en particulier en contexte préhospitalier (La sévérité d’une hémorragie peut être estimée par l’indice de choc).
L’intérêt de l’échographie FAST
Chez le patient sévère ou instable, il est aussi recommandé d’estimer la cinétique des pertes sanguines par la répétition d’échographies FAST, particulièrement utiles en pré-hospitalier, afin de ne pas sous-estimer l'importance d'une hémorragie active et de suivre l'efficacité des thérapeutiques mises en œuvre.
Cela offre aussi la possibilité d'un bilan dynamique objectif, particulièrement utile pour préparer l'accueil du patient au déchocage (sévérité du patient, anticipation des complications, préparation de la transfusion hospitalière, nombre d'intervenants nécessaires à l'accueil du patient, etc.).
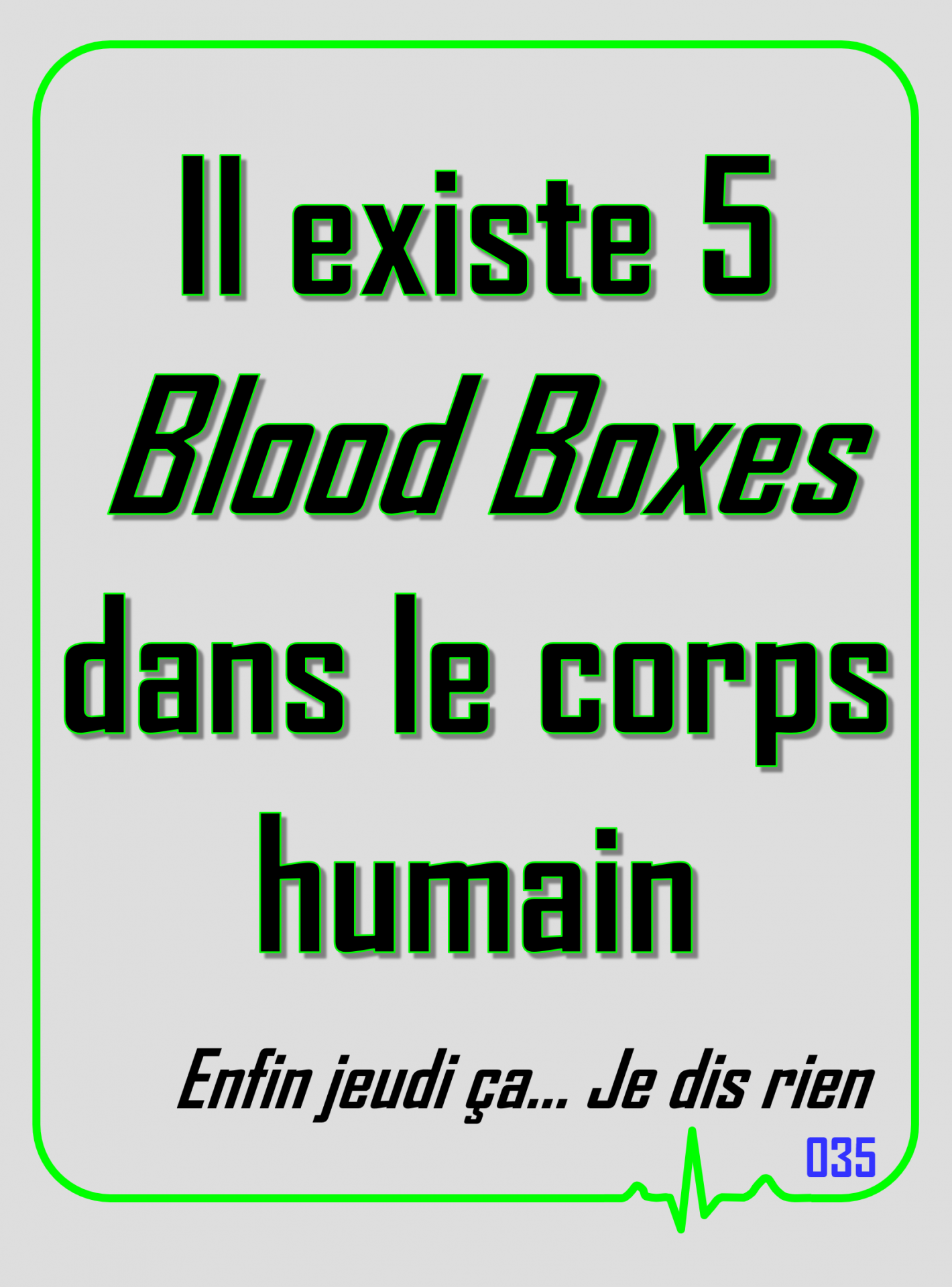
LES POINTS CLÉS
Les «Blood Boxes» (thorax, abdomen, bassin, et fémurs) sont des zones à haut risque hémorragique cruciales à évaluer en cas de traumatisme.
Le score A.B.C., basé sur quatre critères, aide à identifier les patients nécessitant une transfusion massive en urgence.
L’indice de choc et la répétition de l’échographie FAST sont des outils utiles pour le suivi hémorragique, particulièrement en préhospitalier.
www.sfmu.org/upload/30_vieprofessionnelle/4_outils_pro/1_protocoles/04_aidecognitive/aides_cognitives_trauma_intra_211006.pdf